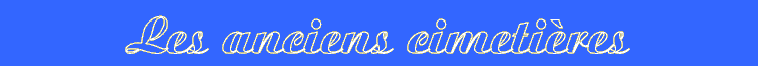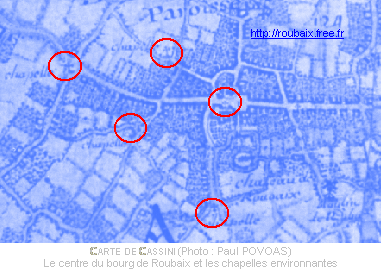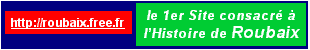|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
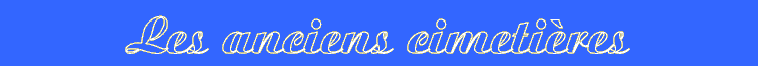 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Une évolution unique en France
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comme déjà rappelé à plusieurs reprises dans les pages de ce site, Roubaix eu à se faire grandement distinguer en France par l'explosion démographique qui fut sienne et à même hauteur que le considérable et remarquable développement de son industrie. Ainsi, au début 1900, alors que l'indice démographique, au niveau national, était de 4, Roubaix subissait une multiplication de sa population par 15.
Ce fait paraissait incontournable. Qui dit accroissement économique dit aussi accroissement de la population, et, en définitive, accroissement du nombre d'inhumations parfois amplifié par les phénomènes d'épidémies qui faisaient de véritables ravages dans la population roubaisienne.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
Pour les administrations municipales successives, faire face à ce phénomène d'accroissement de la demande d'inhumations n'était pas des plus simples à résoudre. Cela entraînait moult modifications du cimetière, nouveaux projets de construction, pour que cet accroissement puisse s'adapter à la contenance maximale que pouvait offrir le cimetière.
Roubaix connaîtra donc successivement au cours de son histoire pas moins de 4 cimetières principaux avant de parvenir à la création de l'actuel cimetière. D'autres cimetières furent néanmoins établis, pour des raisons particulières et pendant des périodes plus ou moins longues, en différents points du territoire communal.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Les petits cimetières particuliers d'antan
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- La chapelle Saint-Georges et Saint-Sébastien
- Le cimetière protestant
- L'épidem
- L'église Saint-Martin
- Le champ de Beaurewaert
- Le cimetière dit « du Fresnoy »
- Le cimetière de l'hospice
|
|
|
|
|
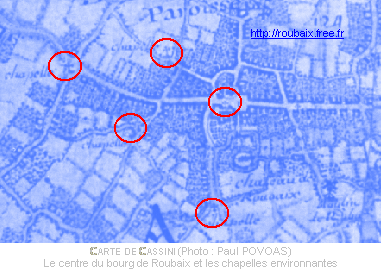 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Au grand regret des historiens, la plupart de ces petits cimetières ne nous ont légués que peu de traces dans les archives municipales.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les hypothèses vont donc bon train… Leurs situation géographique, contenance, durée d'existence, et autres particularités, restent donc pour les contemporains que nous sommes d'une grande incertitude.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Saint-Georges et Saint-Sébastien
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A l'angle de la rue Saint-Georges et du sentier du Trichon (actuellement rue du Général Sarrail et rue du Bois), l'on trouvait une chapelle derrière laquelle se trouvait autrefois un petit cimetière dont l'existence n'a laissé aucune trace aujourd'hui dans les archives municipales. Néanmoins, il circule de nos jours l'hypothèse que la création de ce cimetière daterait de l'époque de l'érection même de la chapelle et, en conséquence, que les premières inhumations y pratiquées le furent dans la seconde moitié du XVème siècle (1).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Lors de la création de la Compagnie des Arbalétriers en 1491, par Pierre de Roubaix, ce dernier décida de la construction de la chapelle Saint-Georges, saint patron des arbalétriers, et Saint-Sébastien, saint patron des archers. À cette même époque furent construites les chapelles du Saint-Sépulcre et de l'Hôpital Sainte-Élisabeth. Ces chapelles étaient beaucoup plus vastes que l'église Saint-Martin dans son ensemble puisque la première pouvait contenir 500 personnes assises et la seconde pas moins de 800.
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Là aussi, sur le cimetière protestant, peu de traces nous sont restées. Tout juste connaissons nous la date de création et le lieu d'implantation de celui-ci. Par contre, la durée de son existence est très incertaine et ne fut pas mentionnée lors de la création, plus tard, du cimetière de Beaurewaert, et plus tard encore, du cimetière du Fresnoy.
Pour les « prétendus réformés », terme qualifiant à l'époque les protestants, la création d'un cimetière particulier fut décidée en date du 19 avril 1710 dans le but de satisfaire aux injonctions faites par les États-Généraux des Provinces Unies (2). Les échevins de Roubaix décidèrent, promptement, que la création d'un tel cimetière se ferait à l'emplacement du cimetière « Saint-Georges » mais, sur intervention de Monsieur Jean Baptiste DEBADTS, curé de la paroisse Saint-Martin, cette création fut conditionnée à la démolition totale de la chapelle Saint-Georges et Saint-Sébastien, laquelle chapelle fut profanée quelques 40 années plus tôt. À cette condition fut adjointe celle de la construction d'une muraille suffisamment haute pour que les roubaisiens marchant dans la rue ne puissent voir ou entrevoir les sépultures. L'on comprend ici quelles étaient les considérations du clergé à l'égard de la religion protestante, pestiférée parmi les pestiférés.
Le 10 juillet 1710, à Tournai, le vicaire-général COLBERT autorise la démolition de la chapelle, à laquelle s'enchaîne tout aussi rapidement la création du cimetière des « égarés ».
L'état des comptes des arbalétriers, de 1711, laisse apparaître en recettes la somme de 90 livres 2 sols pour « aultre moitié dans la vente des matériaux de la chapelle qui a été démolie... ».
En 1710 déjà, la vente du fonds de la chapelle Saint-Georges et Saint-Sébastien rapporta à chacun des co-propriétaires (des archers et des arbalétriers) la somme coquette de 142 livres 4 sols et 6 deniers.
Pour la même année, les comptes du Magistrat de Roubaix mettent en évidence une dépense de 58 livres 16 sols réglée « pour deux chartées de chaue et cendre qu'on a fait amener de Tournay pour la construction de la muraille faite pour servir de cloture au chimetière de la chapelle de St Georges démolie, lequel chimetière est destiné aux prétendus réformés… ».
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) À cette époque, la France était sous domination Hollandaise.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A chaque période d'épidémie de peste, et Roubaix en connu de terribles en 1637, 1669 et 1769, la cité roubaisienne eut pour contrainte le choix rapide d'un terrain, situé en dehors du bourg, permettant l'inhumation des pestiférés, évitant ainsi toute propagation de la contagion, encore qu'il n'était plus possible pour les « petites gens » de faire inhumer leurs parents ou amis. Comme à toutes les époques, des dérogations « spéciales » étaient néanmoins accordées en contrepartie d'une rétribution conséquente au profit de l'église. Bien évidemment, cette contrepartie ne pouvait être accessible qu'à l'élite roubaisienne. Les riches avaient donc droit de faire enterrer leurs parents ou amis, les pauvres, quant à eux, n'avaient que pour seul droit celui de pleurer leurs morts. Ce fait est avéré par le compte de 1637 qui mentionne très clairement des recettes de ce genre, venant « de diverses personnes morts de la peste pour estre enterré en la chimentière... ».
Sur ces cimetières ponctuels, là aussi, les traces de leur existence sont peu nombreuses dans les archives municipales. C'est en date du 30 janvier 1669 que les échevins de Roubaix obtiendront l'autorisation de contracter un emprunt pour « acheter en divers endroits de la paroisse aucuns fonts, tant pour sur iceux bastir quelques trois à quattres demeures que enterrer les morts pestiférés, faisant des enclotures de murailles ou autres… ». Munis de cette autorisation, les échevins roubaisiens acquirent un terrain, situé au Nord-Ouest en bordure du chemin menant de l'Auberge de l'Alouette à la Fosse-aux-Chênes (c'est à dire entre les rues de l'Hospice et des Champs, actuellement). Ils y firent donc construire un asile destiné à recueillir les pestiférés, entouré de murs de paillotis, et y établirent un cimetière pour inhumer ceux d'entre eux qui succombaient à la maladie.
Cette partie du bourg, puis de la ville, pris et garda le nom d' « OPIDEM » ou « EPIDEM » jusqu'à la fin du XIXème siècle. Reste encore aujourd'hui dans les archives municipales le compte de taille des faux frais de cette année 1669 faisant apparaître les différentes dépenses liées à l'installation de ce cimetière occasionnel (3). Pour information, la population de Roubaix en 1673, soit quatre ans après la terrible épidémie de peste ayant entraîné la mort de nombreux roubaisiens, était de 3.657 habitants, répartis en 959 feux (ou plus exactement 959 ménages), soit 2.990 communiants et 667 enfants ayant atteint « l'âge de discrétion ».
Le bourg de Roubaix chargea son sergent, le sieur BULTEAU, de planter -en 1739- des ormes « en nombre » pour assainir ce cimetière.
Une nouvelle épidémie se déclara dans le bourg en date du 27 août 1787. Celle-ci était attribuée aux « exhalaisons » du cimetière situé au contour de l'église Saint-Martin mais également aux eaux servant au lavage des laines. Réuni en assemblée extraordinaire, le Magistrat de Roubaix requit alors auprès du Lieutenant des comtés de Flandre et d'Artois la permission de faire transport - déménager - du cimetière de l'église vers « un terrain déjà lui appartenant et qu'on appelle depuis fort longtemps Opidem ». Cette requête n'eut aucun aboutissement concret à Roubaix et les choses restèrent malgré tout en l'état jusqu'en 1793. Néanmoins il faut sans doute trouver dans ce projet avorté les origines de la découverte, en 1836, lors des travaux inérants au percement de la rue de l'Épidème (incorporée, plus tard, à la rue de l'Espérance) de plusieurs sépultures oubliées.
En 1839, lors de la construction des fondations de l'École des Frères de la Doctrine Chrétienne, rue des Ligne, l'on découvrit une quantité importantes d'ossements humains dont l'on ne sait encore aujourd'hui s'il s'agissait des restes d'inhumations de roubaisiens morts de contagion, et, de manière plus générale, s'il s'agissait d'un autre Opidem, ou Épidem, qui ne nous aurait légué aucune trace de son existence dans les archives municipales.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) « A Jaspart Meurisse pour fourraige par luy livré pour ériger des murs de terre autour de la Lopidenne, 32 livres 10 sols ».
« A Pierre Thonnel, machon pour par luy et son valet avoir travaillé quattres jours à la Lopidenne à ériger les murailles de terre, 8 livres 16 sols ».
« A Franchois Delebecque pour 66 pieds de seulle par luy livrez pour la chimetière des pestiféréz, 14 livres 17 sols ».
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
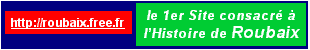 |
|
|
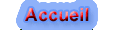 |
|
|
|
|
|
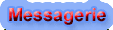 |
|
|
|
|
|
|
|
|