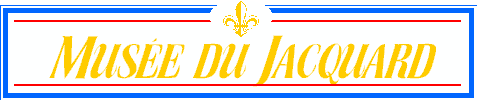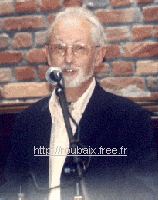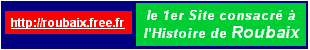|
Après en avoir fait une ville en agglomérant le petit bourg qu'était Roubaix, et en lui formant une enceinte, Pierre de Roubaix (1449-1498), très puissant Seigneur de Roubaix, voulut en donner les autres caractères, notamment le droit d'y exercer le commerce et les manufactures.
C'est ainsi qu'il obtint de son ami le Duc Charles, dit « Charles le Téméraire », une charte datée de La Haye du 1er novembre 1469 octroyant à Roubaix son premier privilège de fabrique en accordant « aux manants et habitants de Roubaix, de grâce spéciale, puissance et autorité, qu'ils puissent dorénavant licitement drapper et faire draps de toutes laines portant scel et marque que le dict Seigneur de Roubaix leur fera bailler ».
Cette « Charte des Drapiers » allait transformer radicalement le paysage roubaisien en métamorphosant un simple petit bourg en une ville entièrement industrialisée, véritable fourmilière de manufactures dans lesquelles étaient travaillés le lin, le coton, la laine et le chanvre. Le petit bourg prospéra économiquement si fortement que Roubaix devint capitale de l'industrie textile, aussi puissante que l'était à l'époque sa principale concurrente, la ville de Manchester.
Dès 1821, l'écrivain Jouy, de l'Académie Française, au cours d'un voyage dans la région, écrivait : « J'avais entendu parler souvent des progrès de notre industrie dans le Nord… mais c'est à Roubaix que j'ai pu me faire une idée de la prodigieuse extension qu'elle a prise. Le bruit des machines, des mécaniques, des moulins, vous rompt ici la tête. Il n'y a coin si reculé de grenier, de cave, que l'industrie n'occupe… ».
À cette époque remontent deux facteurs qui devaient amener une véritable révolution dans l'industrie : l'adoption de la machine à vapeur, dont la 1ère à Roubaix fut installée en 1820, et l'invention de la mécanique Jacquard, importée de Lyon dans le Nord par un Roubaisien, Monsieur Grimonprez, en 1828. Cette dernière innovation, qui deviendra la spécialité de l'entreprise CRAYE, s'introduisit à Roubaix à un moment où, après avoir joui d'une prospérité inconcevable pendant une trentaine d'années, l'industrie du coton était tombée, en 1832, dans le marasme le plus complet puisqu'en l'espace de quatre années la production en filature avait diminué de près de 90 %.
De telles inventions, améliorant nettement la production, la qualité et le rendement, semblant devoir frapper de discrédit la main-d'œuvre ouvrière, contribuèrent au contraire à y faire appel dans une proportion toujours croissante.
Malgré cela, les conditions de vie des ouvriers se dégradaient et des conflits s'amorçaient. Dès le seconde moitié du XIXème siècle, la création entre autres de « l'Usine Monstre », par les frères Motte, va permettre à Roubaix de passer de la manufacture à l'usine. C'est à cette même époque qu'arrivèrent d'énormes vagues d'ouvriers flamands, courageux et expérimentés, pour pallier au manque de main-d'œuvre. Entre 1872 et 1891, Roubaix fut appelée la 4ème ville belge, après Anvers, Bruxelles et Gand.
|
|