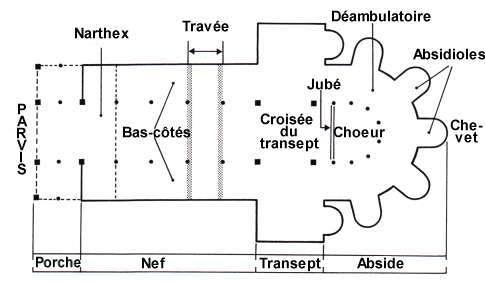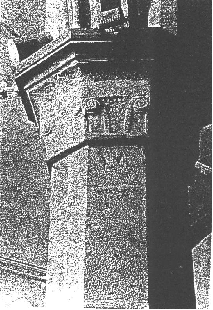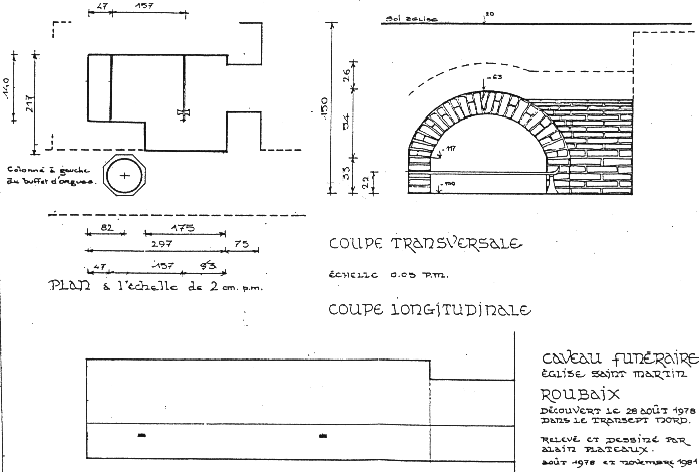|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vers l'Est, des arcades transversales séparaient la nef du chœur. Là, les colonnes sont octogonales, avec de mêmes bases et de pareils chapiteaux. C'est une nouvelle ressemblance avec Saint-Christophe. Quant aux arcades placées ainsi comme des arcs triomphaux à l'entrée du sanctuaire, elles sont courantes dans les hallekerques régionales. Au-delà s'ouvre un triple cœur dont l'axe diverge notablement de celui des nefs.
Trois arcades élégantes reposent de part et d'autre du sanctuaire principal sur deux colonnes fines et sveltes, séparant ainsi les trois vaisseaux de mêmes largeurs que les nefs.
|
|
|
|
|
|
|
|
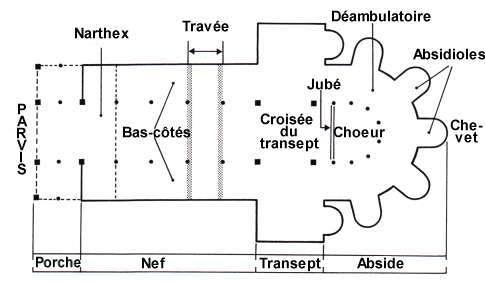 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Au centre, un abside à cinq pans percés de verrières à remplages achève le chœur proprement dit.
À l'extérieur, chaque baie s'abrite sous un pignon, formant une couronne du plus bel effet. Les chapelles latérales se terminaient par un pignon plat percé d'une vaste fenêtre axiale (la partie inférieure de la fenêtre du pignon Nord est encore visible dans l'édifice actuel, derrière le tabernacle). Dans les murs latéraux, deux fenêtres venaient compléter l'éclairage abondant de ce vaste sanctuaire où reposaient de nombreuses dépouilles nobles. La plus ancienne dont le souvenir nous est conservé datait de 1409. Très modifié au XIXème siècle, le chœur et ses chapelles latérales sont difficiles à dater précisément. Mais le dessin des bases des petites colonnes encore en place, le style des baies latérales, peuvent faire penser aux XIVème siècle finissant ou au début du XVème siècle.
Comme les nefs, cette partie de l'église était tout en pierre blanche sur un soubassement fait de pierres bleues utilisées en remploi. L'ancienne charpente existe aussi vers le Sud. Ce n'est qu'un berceau brisé sans nervures. Les sablières n'ont pas été retrouvées lors des travaux. Disons également que ces derniers ont permis de trouver sous l'ancien autel une grande dalle en pierre de Tournai à la bordure moulurée et marquée des cinq croix de consécration qui ne font aucun doute sur sa destination primitive en autel. Une base de baptistère roman se trouvait au même emplacement, assez proche de celle visible à Chéreng (cette base est carrée, en pierre bleue, avec des feuilles aux angles. Elle a été réutilisée comme socle du bénitier dans le porche par Claude de Plaesse, décorateur roubaisien, auteur également du dessin de l'autel remployant des panneaux de la chaire de 1673 sculptée par Huterelle, de Courtrai).
|
|
|
|
|
|
|
|
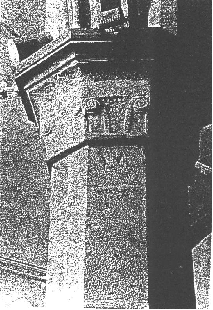 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accolés aux murs latéraux des nefs, au Nord et au Sud, s'élevaient des chapelles en hors d'œuvre, accolées par paire de chaque côté. Deux d'entre elles sont bien datées par les épitaphes de leurs fondateurs. Au Sud, c'est la chapelle de Saint-Pierre dûe à la libéralité du curé Pierre de Vernay, mort en 1468, qui « à ses dépens fist faire ceste capielle » et où il reposait. C'était un petit édifice de plan carré terminé par un pignon aigu percé d'une baie à remplage flamboyant. Au Nord et en face de la précédente, s'ouvre la chapelle fondée en retour de terre sainte par le seigneur du lieu, l'illustre Pierre de Roubaix. Son fastueux tombeau élevé après sa mort en 1498 rappelait que « fut faicte ceste capel en l'honneur et révérence de la Saincte Croix ». Une travée carrée était prolongée par une abside à trois pans, avec des baies flamboyantes et des contreforts. Ces deux chapelles peuvent avoir formé transept aux nefs primitives, étant donné leur position en face de la troisième travée, mais ce n'est encore que supposition.
Vers l'Est, et mitoyenne à ces chapelles, deux autres, beaucoup plus vastes, s'ouvraient dans la dernière travée proche du chœur et formaient un second transept achevé de chaque côté par des absides à pans coupés au nombre de trois confortés aux angles par des contreforts talutés entre lesquels s'ouvraient des fenêtres. Ces contreforts se raccordaient tant bien que mal aux maçonneries des deux précédentes chapelles, accusant deux époques de construction.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chapiteau des colonnes du transept (1521)
état après enlèvement des ajouts en plâtre
lors de la restauration en août 1970
Photo : Alain Plateaux (08-1982)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le comble, en croupe, rejoignait celui des nefs latérales avec un faîte commun. Une disposition semblable se voit à l'église de Bousbecque (XVIème siècle). On ne sait quand exactement furent élevées ces chapelles mais il semble qu'il faille les rattacher à la même campagne de travaux que les nefs, vers 1520. Pourtant, celle du Sud abritait les splendides tombeaux de Jean de Roubaix et d'Agnès de Lannoy (1449 et 1404) mais les épitaphes n'attribuent pas la construction aux illustres occupants.
On peut imaginer qu'ils y furent transférés par la suite.
En face, et en tous points semblables, il y avait la chapelle dite « Castrale ». En dessous, un tombeau maçonné en briques fut découvert en 1978. Sa destination seigneuriale ne fait aucun doute mais les quelques vestiges de sépultures qui s'y trouvaient sont restés anonymes. Des accès latéraux à ce caveau restent énigmatiques. Des barres de fer supportaient autrefois le ou les cercueils dont il ne restait qu'une partie des ferrures.
|
|
|
|
|
|
|
|
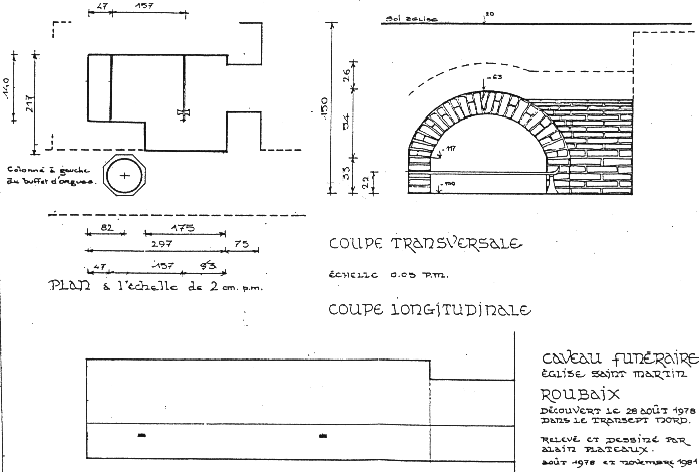 |
|
|
|
|
|
|
|
En préparant les fondations du futur orgue de l'église Saint-Martin à Roubaix, une excavation a éventré un vaste caveau funéraire le 28 août 1978. Avant d'être recouvert par la dalle de béton, ce caveau a été relevé et photographié.
Il s'agit d'un caveau rectangulaire bâti en grandes briques assez mal maçonnées. Sa longueur est de 2,97 mètres et sa largeur de 1,40 mètres. Un sol est fait de briques posées à plat. Sur le côté gauche, vers le Sud, un espace augmente le plan et s'étend jusqu'à une maçonnerie en pierre qui fut également découverte et qui mesure 1,50 mètre de large et passe sous les piliers du transept dans une direction Est-Ouest.
Le caveau est voûté presque en plein-cintre et une petite voûte transversale couvre l'espace latéral. Le mur du fond vers l'Ouest est plein. Son vis-à-vis vers l'Est est percé d'une ouverture en plein cintre dont la face externe fut également visible. Cette ouverture donne actuellement en pleine terre. Le mur mesure 0,75 mètre d'épaisseur.
Deux barres de fer placées à 0,22 mètre du sol étaient destinées à supporter les cercueils. Celle placée vers l'Ouest est scellée dans les murs latéraux. L'autre, à l'Est, est scellée dans le mur de droite et repose à gauche sur un pied en fer forgé en forme de patte aplatie.
Une forte humidité règne dans ce caveau presque entièrement rempli de terre. Une couche de chaux, d'environ 0,10 mètre d'épaisseur couvre le sol. Au-dessus, une couche marron semble être ce qui reste des cercueils dont deux ferrures furent retrouvées dans la terre.
Dans cette terre se trouvaient aussi deux carreaux vernissés, l'un blanc, l'autre vert, semblant provenir d'un carrelage (celui de l'église ?). Des corps, il ne restait qu'un crâne.
Ce caveau, postérieur au XVème siècle, se situait dans la chapelle Notre-Dame, chapelle castrale, de l'ancienne église, formant transept à abside, et dont il longeait le mur latéral Ouest.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vers l'Ouest, une puissante tour fut entreprise vers 1511 si on interprète bien le texte daté de cette année là. Le modèle est courant dans la région lilloise et on en connaît une bonne quarantaine élevées entre le XVème et le début du XVIIème siècle. À Lille même, l'église Sainte-Catherine présente l'exemple le plus parfait peut-être (1504). La tour de Saint-Martin est bâtie sur un plan carré avec des contreforts en équerre aux angles. Elle est tout en pierre à l'exception de la voûte du porche refaite en 1673, dix ans après un grave accident survenu au clocher et à la nef centrale à cause de la foudre.
Le porche, mesurant 6,08 mètres de côté, a des murs de 1,50 mètre d'épaisseur à la base. Très élevé, il s'ouvre à l'extérieur par un portail mouluré à l'arc en ogive Tudor dont la clé porte les armes des Roubaix. Soubassement et mouluration sont taillés dans le grès. Une vaste fenêtre, ayant encore ses ferrures d'époque, éclaire abondamment cette entrée solennelle. Les trois autres murs sont percés d'arcades aux piédroits aux angles largement rabattus, ayant ainsi un tracé en trois pans dans lesquels s'amortissent les moulures complexes des arcs.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|