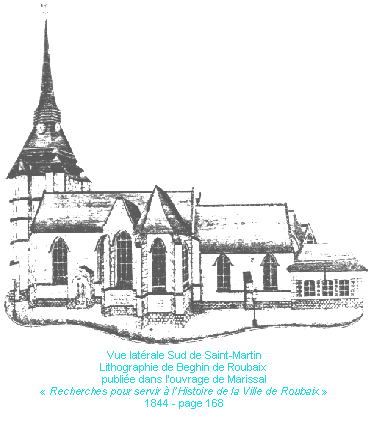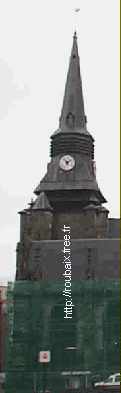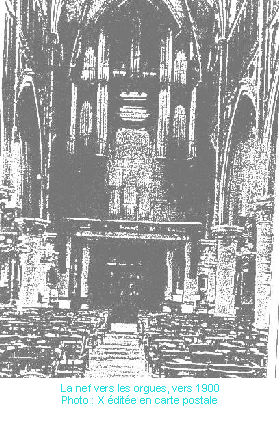|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Si l'arcade s'ouvrant vers la nef est traditionnelle dans ce genre d'église, celles des côtés sont, ici, énigmatiques. En effet, jusqu'en 1845, cette tour était en avant des pignons de l'église et sur les plans connus, les cadastres en particulier, il n'y a pas de construction de part et d'autres. Comme on ne peut imaginer qu'après avoir franchi le portail on se trouverait encore dans un porche ouvert à l'air libre, il y a là une étrangeté dont l'explication nous échappe pour l'instant. Il faut cependant remarquer deux choses :
Les maçonneries n'accusent aucune reprise, ce qui exclut une modification survenue au XIXème siècle. Ensuite, la tourelle d'escalier qui est incorporée aux contreforts Sud-Ouest est en partie engagée sous l'une de ces arcades. La porte d'accès à cette tourelle est située de part et d'autre du parement extérieur de la face latérale du clocher… Il est dommage qu'il n'existe pas de plan de l'église avant sa transformation pour nous renseigner avant d'éventuelles reconnaissances archéologiques (à la demande de Théodore Leuridan, l'architecte Leroy fit un plan de Saint-Martin en 1850, conservé aux archives de Roubaix. Malheureusement, ce dessin est faux en plus d'un point, ce qui pose d'ailleurs pas mal de questions… Cependant, l'entrecolonnement primitif peut être restitué avec précision grâce aux divisions de la charpente de la petite nef Sud.).
|
|
|
|
|
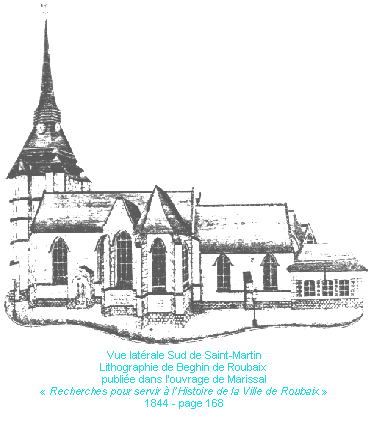 |
|
|
|
|
|
|
|
*après 1985 furent découverts quelques nouveaux éléments que vous trouverez dans les pages suivantes titrées :
« quelques apports nouveaux à l'histoire de Saint-Martin ».
|
|
|
|
|
|
|
|
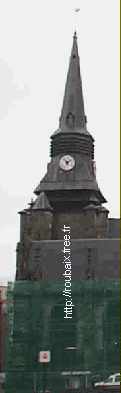 |
|
|
|
|
Cette tour qui débute si majestueusement ne sera jamais achevée. La maçonnerie s'arrête au ras de la chambre des cloches, amputant le projet de deux étages délimités extérieurement par des cordons moulurés. Là auraient dû s'ouvrir les hautes baies jumelles que l'on voit ailleurs. La tourelle d'escalier octogonale s'arrête au même niveau où cessent aussi brutalement les contreforts. Sur deux pans de cette tourelle se lit la date de 1571 en ancrages de fer forgé (Leuridan et quelques autres y ont lu 1471; le premier pour prouver que Saint-Martin était l'œuvre de Pierre de Roubaix. La Commission Historique, en 1925, avait déjà protesté contre cette lecture erronée. On peut seulement s'interroger sur le long temps écoulé entre 1511, date présumée de début de travaux et 1571, finition obligée du chantier inachevé.).
Les tours de Marcq-en-Baroeul (vers 1560), de Wattignies (1560) et Neuville-en-Ferrain sont pareillement inachevées. Peut-être faut-il y voir l'une des conséquences des troubles religieux et politiques ayant marqué la fin du XVIème siècle en notre pays ?
Lorsque la prospérité revint, le chantier ne fut cependant pas repris et une flèche en charpente viendra couvrir cette puissante base au profil austère. Ainsi fut-elle dessinée vers 1615 pour les Albums du Prince de Croÿ. Ce couronnement fut détruit par un orage en 1663. Une nouvelle flèche plus élevée et plus élégante sera construite peu après.
Décapitée pour recevoir le télégraphe Chappe, elle sera heureusement remise en son état d'origine en 1824 (cette étude sur l'ancien Saint-Martin se démarque totalement de celle de Marissal (1846) et de Leuridan (1859). Ce dernier estimait cette église construite en une seule fois par Pierre de Roubaix (1415-1498). Non seulement la construction elle-même démentait cette affirmation mais encore les archives et les dates inscrites sur l'édifice contredisent totalement cet avis.).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Face à l'impressionnant château des anciens seigneurs de Roubaix et maintenant en ruines promises à une prochaine disparition, encore entourée de son cimetière, Saint-Martin se trouve peu à peu au cœur d'une grande cité du début du XIXème siècle. Un agrandissement était nécessaire pour les besoins d'une population sans cesse en augmentation. Et puis les idées changeaient aussi; cette église ne plaisait plus à l'élite du temps.
À partir de 1848, le doyen Maes confie à l'architecte Charles Leroy le soin de transformer cette église campagnarde. L'époque redécouvre le gothique à travers le Romantisme et les édifices jugés exemplaires de l'Ile de France ou de Picardie. Les particularités du style régional que l'église représentait alors étaient méprisées et jugées indignes d'être conservées. On dit qu'il faudra toute l'énergie du doyen pour garder au projet de transformation quelques éléments pouvant rappeler l'esprit antérieur. L'architecte, alors tout jeune, arrivera à concilier la volonté du pasteur avec la mode du temps qui voulait pour chaque église une réplique de cathédrale… Un reflet significatif de l'esprit qui régnait alors est donné par la lettre adressée par les fabriciens de Saint-Martin au Maire de Roubaix le 27 avril 1851 : « La Fabrique, émue de l'état de dégradation de son église, inspirée par le zèle du Pasteur vénérable préposé à la direction de la paroisse et confiante surtout dans les sentiments dévoués et généreux des paroissiens, a entrepris la restauration du pauvre temple que nous ont légué nos pères; elle s'est mise à l'œuvre avec courage et elle espère qu'elle trouvera les moyens de persévérer dans sa résolution et qu'elle mènera à bonne fin la réédification qu'elle a commencée. Le Conseil Municipal a remarqué que l'édifice sera non seulement restauré et mis en bon état de conservation mais qu'on a cherché à lui donner le caractère monumental dont il était dépourvu : la Fabrique a l'espoir que son œuvre sera comprise et appréciée : elle a cherché autant qu'il était en elle dans cette restauration à procurer l'embellissement du centre de la cité. ».
Les travaux seront considérables et dureront jusqu'en 1852. De l'édifice existant on ne conservera que la tour et quelques murs des chœurs. Les colonnes sont toutes déplacées sauf les octogonales et celles du chœur. Le nombre des nefs est porté à cinq et deux nouvelles colonnades reposant sur les anciens murs gouttereaux répètent celles du milieu. Les chevets plats de ces ajouts sont en deçà du chœur primitif, composant une succession de chapelles décalées d'un heureux effet. La tour est désormais englobée dans ces nefs extrêmes coiffées de combles aigus. Le vaisseau central est surélevé afin de ménager des fenêtres hautes. Les façades multiplient les clochetons, les gables, les pinacles. Celle du transept Sud, donnant vers la Place, est traitée comme si elle était la principale de l'église, avec un grand portail à voussures. Autour de la grande nef, l'architecte a repris avec bonheur les pignons surmontant les baies de l'ancien chœur et en a poursuivi la succession à chaque travée, avec en couronnement un énorme fleuron. Cinq hautes verrières trouent le chevet principal et des vitraux anciens (XVIème siècle ?) y sont replacés avec d'autres exécutés par E. Bourdont et A. Lusson, maîtres verriers de Paris et du Mans. Les pignons des anciens chœurs latéraux sont repris et maintenant percés de triplets. Ceux-ci ont de belles verrières exécutées par Claudius Lavergne (1865).
À l'extérieur, des balustrades entrecoupées de clochetons courent à la base des toits. Les pignons décalés des diverses nefs et des transepts s'achèvent en pinacles et crochets, donnant à la silhouette de l'église un dessin nerveux et offrant des perspectives variées. L'ensemble complété par la couronne de gables de la grande nef est pittoresque et attrayant. Seule la surcharge du pignon du transept vers la Place est sans doute regrettable. Le haut pinacle qui le couronne lutte désagréablement avec la flèche de l'Ouest.
À l'intérieur, les cinq nefs s' étendent harmonieusement. On remarque quelques murs de pierre en remploi, mais ailleurs les murailles sont plâtrées sur de la brique, seul le parement extérieur des nouvelles constructions étant en pierre. Des chapiteaux aux corbeilles feuillues ont remplacé les anciens, sauf aux colonnes octogonales. Mais cela est critiqué et bientôt un décor de plâtre sera plaqué sur le grès pour dissimuler ces ancêtres jugés indésirables. Ils seront à nouveau redécouverts en 1976. Si les arcades surélevées du faux transept ne sont guère élégantes (on en retrouve d'identiques à Saint-Christophe refaits par le même Leroy de 1850 à 1865), le reste de l'architecture est plaisant. Mais c'est la grande nef qui retient toute l'attention car toute la décoration architecturale s'y est réfugiée. Bâtie en pierre de Creil, elle présente au-dessus des arcades qui reprennent les anciens profils deux registres d'arcatures aveugles.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Des cordons et des colonnettes divisent horizontalement et verticalement la composition. Le second niveau est plus creux que le premier et simule un triforium. Au-dessus, et logées dans les tympans des voûtes, des baies réduites aux arcs en ogive éclairent la nef. De multiples combinaisons de cercles entrelacés dessinent des remplages d'un beau dessin. Des vitraux de qualité ajoutent à l'architecture une couleur sans cesse changeante. Cette élévation des murs de la nef trouve peut-être son inspiration dans l'architecture gothique anglo-normande.
Les voûtes elles-mêmes sont hélas en plâtre sur armature de bois. C'est un réseau d'ogives, de tiercerons et de liernes dans le goût flamboyant, avec de grosses clés pendantes en bois sculpté. Cette référence à un art orné est curieuse pour l'époque qui prônait la pureté de l'architecture du temps de Saint-Louis et jugeait le style flamboyant comme étant dégénéré… Le concours institué pour la construction de Notre-Dame de la Treille (Lille) sera très net sur ces exigences et notre architecte y déposera un projet en 1854. Les nefs latérales sont beaucoup plus simples. Elles sont couvertes d'un berceau brisé en plâtre établi sous l'ancien dans le premier collatéral Sud. Des ogives rappliquées concèdent à la mode néo-gothique.
|
|
|
|
|
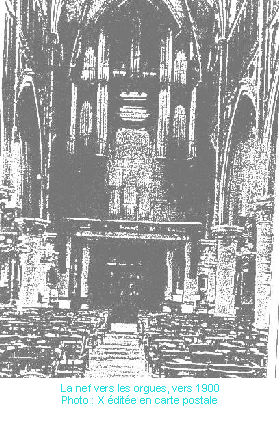 |
|
|
|
|
|
|
|
Disons, en passant, que cet édifice est fragile. Les murs de la grande nef sont peu épais, fortement évidés et lourdement chargés par les pignons supérieurs. De plus, les descentes de charges ne sont pas dans l'axe des colonnes. Des déformations sont visibles à l'œil. Mais ce sont les grandes arcades des faux-transepts qui sont les plus vulnérables, leurs piédroits recevant la poussée des autres arcs des nefs.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Des ancrages ont déjà été nécessaires lors de la construction.
Cette relative fragilité n'exclut pas les qualités du Saint-Martin reconstruit. Ce large vaisseau presque carré, aux détails architecturaux soignés, aux perspectives variées, est parcouru par de belles lumières. C'est avec Saint-Christophe de Tourcoing l'une des meilleures œuvres de Charles Leroy. Cet architecte, chargé de la construction de la cathédrale Notre-Dame de la Treille, ne verra pas celle-ci achevée et son projet est maintenant tellement défiguré qu'il ne peut témoigner en sa faveur. Ces autres églises fort nombreuses auxquelles s'ajoutent celles construites par son frère Jean-Baptiste, sont loin de valoir ce qui a été construit ici et à Tourcoing. Il faut encore relever que Saint-Martin est parmi les premiers exemples du néogothique français débutant en 1837 par la construction de Saint-Nicolas de Nantes.
En fin de siècle, l'église fut entièrement polychromée à l'intérieur avec des couleurs sombres, comme on aimait à l'époque, le tout rehaussé de dorures et de figures. Les meubles furent tout aussi opulents et nombreux, témoins d'une période richissime et au goût ostentatoire. Cette décoration surabondante allait quelque peu dissimuler le cadre architectural, mais cette richesse était au diapason de la prospérité industrielle de la cité, alors à son zénith.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
|
|