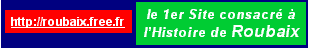|
Dans le dénombrement de 1401, l'on trouve orthographiée « La Vigne » sous « Le Wingne ».
Dite souvent « La Petite Vigne » pour la distinguer sans doute de la « Cense de la Grande Vigne » et d'un autre fief de « Le Vigne » (Le Vingne en 1401), était située entre Beaurieu, La Haye, Courcelles et La Pontenerie, et tenue de la seigneurie de Roubaix à 10 livres de relief et à justice vicomtière. Elle comprennait 15 bonniers 1406 verges de terre, des rentes dues par 15 hôtes et tenants, savoir : 9 rasières, 2 havots 3 quarreaux de froment, 8 rasières 2 havots, 2 quarreaux d'avoine, 9 chapons, 33 sous 8 deniers. Six hommages en relevaient : Le Faufet, Lespierre et quatre autres fiefs innommés.
Une famille du pays qu'on rencontre dans les actes des XIII et XIVème siècles avait retenu le nom de Le Vigne. En 1269, Jean de Le Vigne, homme de fief de Jean, seigneur de Roubaix, était présent avec lui, avec Wattier et Henri de Le Fontaine, Jakesmes de Le Rue et Bouscars de Le Bourde, à l'acquisition d'un fief près de la Riandrie, à Marcq-en-Baroeul (1).
Jean de Le Vigne avait acquis de son neveu Jean de Le Vigne, vers 1282, la terre de le Wassemie (Wassegnies à Roubaix) pour 140 livres 12 sous (2).
Cette terre fut retraite à titre de droit lignager par la sœur du vendeur. Jean de Le Vigne, l'oncle, dut rendre la dite terre, mais soupçonné d'avoir exigé pour cette restitution plus qu'il n'avait lui-même payé, ce qui était contraire au droit coutumier, il fut arrêté par ordre du bailli de Lille. Messire Jean de Roubaix dut intervenir et demander qu'on délivrât Jean de Le Vigne de prison et qu'on fit une enquête pour entendre les personnes qui avaient été présentes à l'achat et à la revente. L'enquête eut lieu, en effet, dans l'église de Saint-Etienne, à Lille, où l'on trouva que ledit Jean de Le Vigne était prud'homme et en conséquence on lui remit les lettres du comte qui le quittait du méfait qu'on lui reprochait.
Jean de Roubaix et Alard de Roubaix, son fils, chevaliers, Watiers de Lespierre, de Wattrelos, frère de Jean de Le Vigne, et Ansinus de Thirepret, d'Hem, déposèrent dans cette enquête en faveur du prévenu. Jean de Le Vigne, le neveu, y déclara que si on soupçonnait son oncle d'avoir plus reçu que payé, c'était par haine particulière contre lui (3).
En 1401, Jacques de Lespierre possédait Le Wingne; en 1458, le fief était aux mains de Jean Carpentier. A la fin du XVIème siècle, Me Wallerand du Courouble, Me Claude du Courouble, son fils, et Wallerand du Courouble, son petit-fils, se succédaient à la seigneurie de Le Vigne. Ce dernier en était possesseur en 1621 et, en la relevant, il avait dit ou du dire, comme ses prédécesseurs : « A mon fief de La Vigne appartient sang et larron, avoir de bâtard, biens épaves, afforage, tonlieu et toute justice de vicomte pour laquelle exercer j'ai bailli, lieutenant, hommes de fief, juges cottiers et sergents. Je dois au seigneur de Roubaix 10 livres de relief à la mort de l'héritier, le dixième denier à la vente, don ou transport et service en cour comme les autres féodaux dudit seigneur. ».
Cette énumération laconique de droits et de charges appelle quelques explications qui, données ici pour La Vigne, s'appliquent d'ailleurs à tous les fiefs de même nature.
D'après certaines sources, tout laisse à penser que la « Petite-Vigne » fit retour au marquisat de Roubaix par acquisition, sans doute, dans la seconte moitié du XVIIème siècle. Le 13 janvier 1719, André François Lespagnol, écuyer, seigneur de Courbes, acquit du duc de Melun, marquis de Roubaix, la moitié de cette seigneurie ou 8 bonniers moyennant une rente annuelle de 12 livres 16 sous parisis (4).
Le censier de Le Vingne, Raphaël, figure au nombre de ceux qui, en 1520, allèrent quérir des pierres à Lezennes pour l'église de Roubaix (5).
En 1742, la cense de La Petite-Vigne était exploitée par Jean Baptiste Coisne (6), d'une famille qui a fourni des échevins et des officiers municipaux à la fin du dernier siècle mais qui, sous ce rapport, n'a pas franchi l'année 1800.
En 1824, A. Coisne était au nombre des 80 principaux fermiers qui n'avaient pu obtenir l'érection du territoire rural de Roubaix en commune séparée et qui demandaient alors l'exemption des droits d'octroi sur leurs récoltes.
VAN REUST Philippe
Fils d'Antoine
Epoux à Tourcoing le 14.03.1669 de LAMBELIN Louise, fille de Balthazar
Cité le 12.01.1673 (ADN Tab.8267.50)
CORNILLE Jacques
Fils de Gilles, décédé à Roubaix le 04.05.1699
Epoux à Roubaix le 09.09.1671 de DEHARNES Marie, fille de Denis et d'Antoinette FOURNIER, décédée à Roubaix le 27.07.1709
Cité le 14.07.1681 (ADN Tab.8275.23)
Cité le 08.01.1682 (ADN Tab.8276.01)
Bail du 12.09.1684 (ADN Tab.8278.61)
Cité le 12.05.1708 (ADN Tab.9414.37)
CORNILLE Gilles
Fils de Jacques et de Marie DE HARNES
Epoux de AGACHE Jeanne, fille d'Antoine et de Marie BAYART
Avant-bail dans contrat de mariage du 12.05.1708 (ADN Tab.9414.37)
Cité le 28.11.1718 (ADN Tab.585.111)
Cité le 04.03.1738 (ADN Tab.8262.08), déport de la cense
COISNE Jean Baptiste
Né Wambrechies (59) entre 1704 et 1711 selon les sources, décédé Roubaix 27.08.1754
Epoux à Roubaix le 23.07.1737 de CORNILLE Marie Joseph, fille de Gilles et de Jeanne AGACHE, née à Roubaix le 18.01.1713, décédée à Roubaix le 13.09.1741
Epoux en 2ème noces de VAN DE BEULQUE Marie Joseph, décédée Roubaix le 25.04.1788
Entré en cense le 15.03.1738 (ADN Tab.8262.08) suivant déport de la mère de la dite Marie Joseph CORNILLE
Cité le 01.04.1761 (ADN Tab.2134.41)
Bail du 14.05.1766 (ADN Tab.2139.43)
Bail du 04.05.1774 avec Louis Joseph et Isidore Joseph COISNE, ses deux fils (ADN Tab.2147.82)
|
|