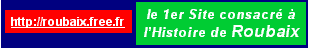|
Le domaine de Maufait, Maufet, appartenant aux seigneurs de Roubaix et formant une des censes les plus considérables du pays, est fréquemment cité dans les actes dès le XIIIème siècle, surtout à propos de seigneuries et de terres situées dans son voisinage; mais ces citations ne contiennent guère de renseignements sur ses origines et sa constitution.
Dans l'acte de partage entre les enfants de dame Isabeau de Roubaix, fondatrice de l'Hôpital Sainte-Elisabeth, veuve de Jacques de Luxembourg, partage qui eut lieu le 7 juin 1502, la terre de Maufait est attribuée à l'aînée, dame Isabeau de Luxembourg, épouse de Jean de Melun, chevalier, seigneur d'Epinoy, de Wingle et connétable de Flandre, à charge de livrer chaque année, à l'Hôpital Sainte-Elisabeth, suivant la volonté de la défunte, 52 rasières de blé pour être converties en farine et données en aumône tous les lundis de l'an, à quatre pauvres et honnêtes ménages de Roubaix (1).
Plus tard, le 3 octobre 1545, Hugues de Melun, premier Prince d'Epinoy, connétable héréditaire de Flandre, châtellenie de Bapaume, etc, descendant de Jean de Melun et possesseur de la terre de Maufait, épousa l'héritière de Roubaix, Yolente de Werchin et en eut trois fils et deux filles dont l'une, Marie de Melun, femme de Lamoral, Prince de Ligne, réunit en ses mains les biens de la maisons de Melun et ceux de la maison de Werchin (2) et c'est ainsi que la terre de Maufait revint aux seigneurs de Roubaix.
En 1553, la cense de Maufait est reprise en ce qui touchait les impôts, pour un revenu de 499 livres 10 sous.
En 1633, on la comprenait pour 44 bonniers 8 cents dont 27 formaient le fief de Faufet relevant des seigneurs de Roubaix à cause de leur seigneurie de la Petite-Vigne, et une branche de la dîme féodale.
Le 27 décembre 1699, la cense de Maufait fut cédée au Prince de Bournonville pour un droit de Quint sur la terre de Roubaix.
Le Prince de Bournonville était petit-fils d'Alexandre de Bournonville qui avait épousé Anne de Melun, fille de Pierre de Melun, Prince d'Epinoy. Celui-ci était légataire de la seigneurie de Roubaix et des autres biens de sa mère Yolente de Werchin, mais par la protection de l'Espagne ces biens avaient été dévolus à sa soeur Marie de Melun, épouse de Lamoral Prince de Ligne. C'est par transaction, comme le dit l'acte qui rapporte ce fait, que la cense de Maufait fut cédée au Prince de Bournonville, en 1669, à titre de quint (3). Elle fut alors dégagée de la redevance de 52 rasières de blé dont elle était chargée au profit de l'Hôpital Sainte-Elisabeth. Le 19 novembre 1728, le Prince de Soubise, marquis de Roubaix, reconnut cette redevance et affecta à la sûreté d'icelle toute la terre de Roubaix (4).
Dans la liste des censiers qui, en 1520, ont été quérir pierres à Lezennes pour l'église de Roubaix, figure la « censeresse de Maufet » (5). En 1633, Jacques Lezaire, l'un des fils du censier de Beaurewaert et de Martine Castel de la cense de La Haye, tenait en ferme de son Excellence le Prince de Ligne la cense de Maufait contenant 44 bonniers 8 cents et dont il rendait, tant en argent qu'en blé et en dîme, 1319 livres 6 sous. Il était échevin en 1650 et avait épousé Gillette de Hallewin qui lui avait donné au moins 7 enfants.
La famille Lezaire dont la venue à Roubaix se perd dans le XVIème siècle peut être comprise parmi les familles échevinales roubaisiennes sinon les plus anciennes du moins les plus recommandables. De 1594 à 1784, cinq Lezaire se sont succédés de père en fils dans les fonctions d'échevins de Roubaix. Elle paraît avoir été en tout temps l'objet des prédilections des seigneurs de Roubaix car on la rencontre exclusivement dans l'exploitation des censes seigneuriales. Beaurewaert, la Digue du Prêt et Maufait. L'une des sœurs de Jacques, Florence Lezaire, née le pénultième de février 1599, avait eu pour parrain Florent de Ligne, marquis de Roubaix, fils de Lamoral, premier prince de Ligne et de Marie de Melun, héritière de Roubaix et pour marraine Yolente Castel, dame de Roubaix. L'aînée des sœurs de Jacques, Pétronille Lezaire, avait épousé en novembre 1610 Jacques de Laoutre, de la cense de la Maquellerie, à ce qu'il soit possible de présumer. Les descendants de Jacques Lezaire, d'une branche cadette de cette maison, paraissent avoir quitté Roubaix dans le cours du XVIIème siècle.
En 1664, le censier de Maufait était Thomas Despatures.
En 1688, c'était Georges Planque. Celui-ci se mit à la tête des laboureurs qui, poursuivis pour le payement de leur cote dans la taille d'une contribution de guerre et de faux frais, refusaient de reconnaître des dépenses faites, disaient-ils, dans le seul intérêt du bourg. C'est un épisode des querelles sans cesse renouvelées au sujet des impôts et qui divisèrent les laboureurs et les manufacturiers jusque dans notre temps (6).
« Les salaires du carillonneur, de l'horloger, de l'organiste, des chantres et musiciens, du prédicateur du carême, des vicaires célébrant la messe de grand matin pour la commodité du public, etc, ne regardent pas les laboureurs, eux qui demeurent hors du bourg et vont à la messe aux villages voisins. Le crieur de nuit ne sort pas du bourg et leur est inutile (7). L'école dominicale et le service d'un médecin pensionnaire sont des établissements propres aux villes closes et non aux bourgs. Pourquoi les faire contribuer aux frais de barrières, de garde et de sauvegarde qui les laissent à la merci de l'ennemi ? On a fait des présents à la princesse d'Epinoy qui a protégé la communauté pendant la guerre et obtenu le maintien de la manufacture menacée par les villes voisines, l'établissement d'un franc-marché et plus de 15.000 florins pour aider les habitants à relever leurs maisons brûlées en 1685; mais tout cela est affaire du bourg et non des laboureurs. Les libéralités outrées du magistrat envers les pauvres ont épuisé la communauté. Ce sont les manufacturiers qui attirent les ouvriers et grossissent ainsi le nombre des pauvres. Le négoce fait la ruine des laboureurs dont la plupart devront, ainsi que le fermier de la Pontenerie, abandonner leurs fermes à cause de l'excès des impositions. Les marchands se bâtissent des maisons comme des châteaux et ont la lâcheté de ne pas vouloir souscrire à l'augmentation de leur taxe. La personne la plus riche du bourg (Jacques de Lespaul) n'est taxée que pour 4 bonniers. D'ailleurs on a faussé le nombre des bonniers de la paroisse. L'échevinage est toujours composé de marchands au lieu qu'on devrait y faire entrer quelques laboureurs pour soutenir leur parti, etc. »
Les échevins répondent que « si en 1689 on a payé le maître de l'école dominicale, c'est que le fermier occupeur des terres affectées à la fondation de cette école a eu ses récoltes ruinées par la grêle. Ils constatent que des 7 échevins, 2 seulement résident dans le bourg, encore l'un d'eux est-il occupeur d'une dîme considérable, et le lieutenant occupe une ferme de 20 bonniers (8). Ils ajoutent que les barrières protègent également les laboureurs qui, pendant la guerre, se retirent dans l'enceinte avec leurs meubles et leurs bestiaux. Les laboureurs veulent chasser de Roubaix les marchands et les artisans dans l'espoir de faire diminuer le rendage de leurs fermes.
Le censier de la Pontenerie a abandonné sa ferme, non à cause de l'énormité des impôts, mais parce qu'étant de la religion prétendue réformée, il a été obligé de quitter Roubaix pour se retirer à l'Ile de Cadzand ».
|
|