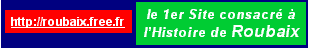|
Un Willaume de La Pontenerie, mort avant 1352, était l'époux de Marie de La Lys, dame de Bousbecque, dont il eut trois enfants:
- Guillaume de La Pontenerie dit de La Lys, qui fit rapport de la seigneurie de Bousbecque le 6 mars 1372;
- Jeanne de La Pontenerie dite de La Lys, épouse de Guillaume de Courteville, écuyer avec lequel elle demeurait à Steenvoorde;
- Marie de La Pontenerie dite de La Lys, qui fit rapport de la seigneurie de Bousbecque le 1er mars 1389 sous le nom de Marie de La Pontelerie. Elle épousa Bauduin de Hingettes, d'une très noble famille de Flandre, et lui apporta la seigneurie de Bousbecque à condition de signer : « Hingettes dit de La Lys »(8).
Noble homme Garin de La Pontenerie, écuyer, mort vers 1391, avait épousé Catherine Buche, de Tournai, veuve de Jean Loncle, dit Kauchevacq. Cette dame avait un fils du premier lit :
- Jean Loncle, dit Kauchevarcq, chevalier, seigneur de Jollaing, mort sans postérité avant 1411, après avoir épousé, avant 1401, noble dame Marguerite de La Pontenerie, laquelle convola, avant 1412, avec Mahieu de Launais, chevalier, chambellan du Roi de France et son bailli de Tournai (9). Dans la déclaration des fiefs et arrières-fiefs de la salle de Lille tenus au service d'armes en août 1417, ce Mahieu de Launais est porté comme seigneur de La Pontenerie (10).
Un peu plus tard, la Pontenerie est aux mains d'Antoine de Werquigneul, chevalier, seigneur de Bauffremez, au Maisnil, époux de Jeanne de Quieuleng, dame de Quiquempois à Flers, petite-fille de Mahaud de Roubaix et arrière-petite-fille de Guillebert, sire de Roubaix (11).
Antoine de Werquigneul fit le pèlerinage de la Terre-Sainte en 1440, étant marié. Par ses lettres de patentes données à Hesdin,le 6 juin de cette année, le duc de Bourgogne octroya à Jeanne de Quieuleng l'autorisation de gérer les biens de son mari durant son absence (12). Il fut prévôt de Lille et commissaire au renouvellement de la loi en 1458. Werquigneul portait d'hermines au croissant montant de sable posé au cœur de l'écu.
Catherine de Werquigneul, dame de la Pontenerie et de Quiquempois, l'une des quatre filles d'Antoine et de Jeanne de Quieuleng, épousa Jacques de Luxembourg, bâtard de Saint-Pol, légitimé en 1486, chevalier, seigneur de la Boutillerie, conseiller et chambellan de l'empereur Maximilien, de Philippe le Beau et de Charles-Quint. Par leurs lettres du lundi de la semaine sainte 1512, les échevins de Lille certifient que Jacques de Luxembourg, bâtard de Saint-Pol, chevalier, seigneur de la Boutillerie, et dame Catherine de Werquigneul, son épouse, ont eu et ont encore vivants deux fils :
- L'un appelé Charles de Luxembourg, qui est l'aîné
- L'autre François de Luxembourg
Que les dits seigneurs et dame de La Boutillerie n'ont pas d'autre enfant vivant; qu'ils ne sont pas bourgeois de Lille, que leurs biens ne sont pas sujets à la bourgeoisie de la ville et que ladite dame Catherine a payé le 30 mai 1493 à la ville le droit d'issue de tous les biens meubles qu'elle y possédait.
Jacques de Luxembourg mourut le 21 juin 1528 et fut inhumé dans la Chapelle des Cordeliers à Lille avec sa femme décédée le 2 octobre 1522. Celle-ci eut pour successeur à la Pontenerie son fils François jusqu'en 1532, époque où la famille Petipas fit l'acquisition de cette seigneurie.
|
|